SONDAGE DE L’APEX SUR LE TRAVAIL ET LA SANTÉ DES CADRES
SUPÉRIEURS 2021
Sommaire
L’APEX étudie la santé et le bien-être des cadres supérieurs depuis 1997. Le Sondage sur le travail et la santé des cadres supérieurs (le sondage) est conçu pour permettre d’examiner les facteurs déterminants sous-jacents de la santé en milieu de travail et les trajets de la causalité. Il s’agit d’observer non seulement les liens directs entre la santé et le travail, mais aussi les causes des causes.
L’accent est mis sur l’interaction entre les facteurs qui augmentent le risque et le stress, et les facteurs qui les diminuent. Ce modèle montre que le milieu de travail a, sur la santé, un impact plus grand qu’un mode de vie habituellement associé à certaines maladies. Il s’agit d’une approche qui se concentre sur les manifestations de la santé (résultats de santé) plutôt que sur les individus ou la maladie.
1.1. Contexte
Ce sondage a été mené entre deux vagues de la pandémie et en pleine phase de vaccination, soit à une période où l’optimisme régnait au sein de la population. Le surcroît de fierté qu’ont éprouvé les cadres supérieurs en contribuant à assurer ces services aux Canadiens leur a coûté cher en santé physique (ils sont 47 % à se sentir en excellente/très bonne santé physique, soit une baisse de 10 % par rapport au dernier sondage) et en bien-être mental (ils sont 38 % à se sentir en excellente/très bonne santé mentale, soit une baisse de 16 % par rapport au dernier sondage). Ils sont épuisés et ont peine à récupérer, conscients des nouveaux défis qui attendent le gouvernement fédéral, notamment les pressions budgétaires, les changements climatiques et la réconciliation. Le travail virtuel exacerbe les éléments clés des résultats organisationnels.
Dû en grande partie à la situation causée par le système de paye Phénix, le niveau de stress des cadres supérieurs avait connu en 2017 une hausse qui avait renversé les tendances positives de 2007 à 2012. En 2021, nous retrouvons les niveaux de 2012 sauf pour certains résultats clés, comme l’épuisement professionnel, qui ont un impact négatif.
![Image Nuage: Travail, charge, distance, leadership, équilibre, santé, load, agilité, force]() Nuage de mots 1 : Selon vous, quel sera le plus grand défi que le gouvernement fédéral devra relever au cours des cinq prochaines années?
Nuage de mots 1 : Selon vous, quel sera le plus grand défi que le gouvernement fédéral devra relever au cours des cinq prochaines années?
1.2. Thèmes
Certains thèmes émergent de l’analyse des données.
1.2.1. Une combinaison de fierté et d’épuisement
Les cadres supérieurs sont très fiers de leur travail (88 %) et sont résolus à dédier leurs efforts à servir les Canadiens. En raison des longues heures de travail et du travail virtuel, toute la communauté des cadres supérieurs ressent une importante baisse d’énergie. L’engagement à l’égard du travail reste fort (57 %), mais l’épuisement professionnel entraîne une hausse du cynisme qui, à son tour, a un impact négatif sur l’engagement par rapport à l’organisation et à la fonction publique en général.
Un (1) cadre supérieur sur 5 (18 %) travaille pendant des heures à haut risque (soit plus de 55 heures de travail par semaine), ce qui représente une baisse par rapport au dernier sondage. Cependant, le conflit entre la vie professionnelle et la vie personnelle est vécu plus douloureusement par ceux qui travaillent de la maison, particulièrement les cadres supérieurs de plus hauts niveaux (41 %) et les femmes. L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est difficile à atteindre. Il existe également un déséquilibre entre l’effort et la récompense (69 %). Les cadres supérieurs indiquent en effet qu’ils ne sont pas reconnus pour leurs contributions et les efforts qu’ils déploient. Il est à noter que « récompense » n’est pas synonyme de « récompense financière »; il s’agit plutôt d’une reconnaissance interne et externe des efforts. La rétroaction et le soutien des supérieurs comptent.
1.2.2. Les résultats de santé s’expliquent par les changements et la
diversité au sein de la culture organisationnelle.
Le niveau (EX) continue d’influencer les résultats de santé individuels et organisationnels. Ce facteur est cependant éclipsé par les changements démographiques au sein de la fonction publique. Composée à 73 % d’hommes blancs, la communauté des cadres supérieurs était très homogène entre 1997 et 2012. Elle est dorénavant composée principalement de femmes (51 %), tandis que la proportion des représentants des autres groupes aspirant à l’équité en emploi a considérablement augmenté.
De façon générale, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir des marques d’irrespect et des microagressions – qui prennent la forme d’interruptions ou de remises en question de leur jugement – qui les minent professionnellement. Mais les femmes qui indiquent appartenir à des groupes racisés en subissent davantage. Ces expériences peuvent être lourdes de conséquences : dans les mois qui ont précédé le sondage, les femmes qui avaient subi régulièrement des microagressions étaient (1) deux fois plus susceptibles que ceux et celles qui n’en subissent pas de souffrir d’épuisement professionnel, (2) plus de deux fois plus susceptibles d’avoir des sentiments négatifs par rapport à leur travail, et (3) presque trois fois plus susceptibles d’avoir de la difficulté à se concentrer au travail à cause du stress.
1.2.3. Même à petites doses, le harcèlement et l’incivilité ont d’importants
impacts sur les résultats de santé individuelle et organisationnelle.
La preuve de la toxicité du harcèlement est trop manifeste pour qu’on l’ignore. Combiné à l’incivilité et au manque de respect, le harcèlement est de nature insidieuse. Il est question ici d’omission – être exclu ou ignoré, faire l’objet de commentaires méprisants, être humilié en réunion, faire de l’interférence au travail ou cacher des ressources. Le Rapport annuel des SCCS comporte des observations et pose des questions qui permettent de réfléchir aux façons dont les personnes et les organisations peuvent traiter le harcèlement en milieu de travail et éviter l’intimidation et les microagressions en ligne.
1.2.4. Influence du niveau (EX) sur les résultats de santé individuelle et
organisationnelle.
Par-dessus tout, les facteurs déterminants de la santé sont associés au niveau d’emploi. Les cadres supérieurs de plus hauts niveaux – y compris les femmes et les groupes vises par l’equité – déclarent faire face à plus d’exigences et à une charge de travail plus lourde, mais ces réalités sont souvent compensées par l’accès à plus de ressources, par un plus grand contrôle individuel et par un surcroît de reconnaissance. Par rapport aux cadres supérieurs de niveaux inférieurs, ils ont toutefois moins du soutien de la part de leurs supérieurs (19 %) et affichent des taux de rétablissement plus bas (42 %).
1.2.5. Écarts et manque de compréhension.
Il existe une méconnaissance de l’expérience d’autrui notamment entre les cadres supérieurs de différents niveaux et au sein des groupes vises par l’equité. Ce manque de compréhension se ressent dans la reconnaissance et l’action, et constitue encore aujourd’hui un obstacle quotidien pour les femmes et les représentants des groupes vises par l’equité. Ces écarts ne se manifestent pas uniquement lorsqu’il est question de diversité et d’inclusion. Ainsi, il y a un écart entre ceux qui ont des problèmes de santé mentale et ceux qui n’en ont pas. Les premiers ont beaucoup moins confiance au système (52 %) ou aux avantages (49 %).
1.2.6. Rôle de la culture organisationnelle.
Selon les résultats de l’étude, une culture organisationnelle saine est, dans la plupart des cas, caractérisée par une compréhension mutuelle, la sécurité psychologique et un leadership empathique. Rares sont les organisations qui réussissent à bâtir des cultures favorisant l’épanouissement sans qu’il y ait collaboration et entraide entre leurs équipes. Il faut voir la culture comme un ensemble de cercles concentriques. La culture organisationnelle correspond au cercle extérieur; les différents secteurs et fonctions correspondent aux cercles intermédiaires; l’équipe correspond au plus petit cercle. Non seulement les hauts dirigeants façonnent-ils la culture globale, mais ils enseignent aux leaders de tous les niveaux à être attentifs à la façon dont leurs actions s’alignent ou non sur cette culture. La culture est façonnée par le pire comportement toléré.
1.3. Conclusion
On peut dire que les cadres supérieurs ont tenu le coup pendant la pandémie, mais que certains se sont mieux débrouillés que d’autres. Dans l’ensemble, ils sont usés, fatigués, et ils ont besoin d’aide et de temps pour récupérer et faire peau neuve. L’appel à l’action s’adresse à leurs supérieurs et aux organisations. Le soutien des superviseurs est un élément clé des résultats de santé individuelle et organisationnelle. Or, les superviseurs ont aussi besoin de soutien, de reconnaissance et de bonnes compétences de leadership pour être vraiment inclusifs. Selon le Rapport des SCCS, la demande pour des services-conseils confidentiels a augmenté de 52 % depuis 2017. Une proportion impressionnante – 38 % – concerne les superviseurs. « Peu de clients des SCCS ont des supérieurs axés sur les personnes. » Lorsqu’on tente de repérer les meilleures pratiques et les modèles de réussite, on constate que ceux qui sont mis en place dans les organisations à l’extérieur de la fonction publique centrale valent la peine d’être étudiés. Pour la plupart des paramètres, ces organisations affichent de meilleurs résultats que celles de l’administration publique centrale, ce qui est attribuable aux différences systémiques et structurelles qui donnent des cultures et des milieux organisationnels différents.

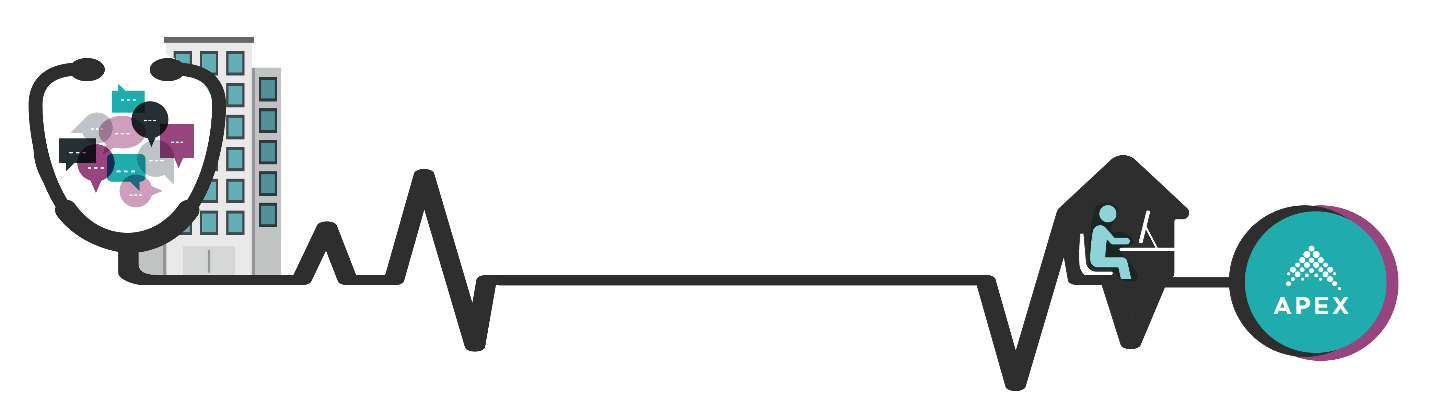
 Nuage de mots 1 : Selon vous, quel sera le plus grand défi que le gouvernement fédéral devra relever au cours des cinq prochaines années?
Nuage de mots 1 : Selon vous, quel sera le plus grand défi que le gouvernement fédéral devra relever au cours des cinq prochaines années?